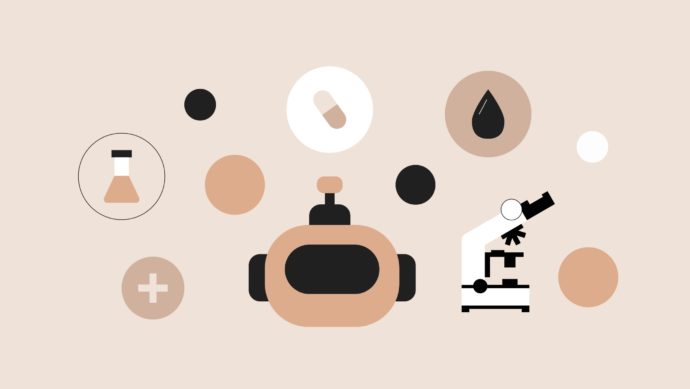
Nous vivons un chapitre passionnant de l’histoire médicale. Si les années 2010 ont été marquées par des progrès non conventionnels en matière de technologie médicale, nous devrions bénéficier d’un nombre encore plus important d’innovations au cours des dix prochaines années. En effet, l’intelligence artificielle (IA) devient de plus en plus intelligente, les robots deviennent de plus en plus précis, et la recherche est plus pointue que jamais.
Bien que personne ne puisse réellement prédire l’avenir de la technologie médicale avec exactitude, il est toutefois utile d’examiner le paysage actuel de ce secteur afin de mieux comprendre où pourraient nous mener les efforts actuellement déployés.
8 avancées médicales à explorer
Beaucoup d’aspects jugés « révolutionnaires » d’un point de vue technologique ne sont pas réellement nouveaux. L’IA, par exemple, est aujourd’hui perçue comme une innovation médicale clé, pourtant, on l’utilise en médecine depuis les années 70, voire les années 50, selon les définitions données. La majorité des gens estiment que l’IA ainsi que d’autres formes de technologie sont révolutionnaires en raison de la rapidité des progrès récemment accomplis.
Les membres de la communauté Sermo sont de cet avis. Au sein de cette communauté privée, un médecin a publié l’article suivant : « Les nouvelles technologies médicales transforment rapidement les soins de santé, présentant à la fois de passionnantes opportunités et des défis potentiels. Les progrès constatés en matière de télémédecine, d’intelligence artificielle et de technologies portables, pour n’en citer que quelques aspects, promettent d’améliorer les soins et l’accessibilité des patients. »
Bien que les options suivantes ne constituent pas de « nouvelles » technologies médicales d’un point de vue purement technique, toutes s’accompagnent néanmoins d’un nombre croissant de recherches et présentent un taux de développement exponentiel. Chacune offre également beaucoup d’espoir pour l’avenir de la médecine.

1. La réalité virtuelle (RV)
Les médecins et les étudiants en médecine utilisent de plus en plus souvent la réalité virtuelle pour toutes sortes d’applications, qu’il s’agisse de gérer la douleur d’un patient en misant sur la distraction ou de répéter des actes chirurgicaux dans le cadre d’une formation par simulation.
Un examen exploratoire publié dans le Journal of Advances in Medical Education & Professionalism a d’ailleurs révélé que les formations qui employaient la réalité virtuelle obtenaient de meilleurs résultats dans 17 études. Plus convaincant encore, cet examen a montré que dans 20 études, la pratique médicale des professionnels formés à la RV présentait un meilleur taux d’exactitude.
Les avantages plus notables de la RV en terme d’application comprennent une amélioration des formations chirurgicales, une réduction du temps consacré aux actes chirurgicaux, et une meilleure compréhension des relations spatiales internes et externes qui existent entre différents organes.
2. La télémédicine
La pandémie de COVID-19 a démocratisé la télémédecine et la santé numérique en règle générale. Selon les chercheurs, la télémedecine continue de jouer un rôle clé dans les soins de santé. La télémédecine présente un intérêt évident en termes d’accessibilité et d’avantages commerciaux.
De nombreux établissements privés utilisent aujourd’hui la télémédecine pour optimiser leurs opérations et générer de nouveaux flux de revenus, en proposant, par exemple, des abonnements en ligne offrant un accès H24 à des soins. En 2024, le nombre de patients ayant consulté un médecin en ligne a dépassé 116 millions à travers le monde, soit une augmentation de près de 100 % comparé à 57 millions en 2019. Au cours de l’année 2025 et au-delà, les médecins contribueront probablement à la poursuite de cette tendance en intégrant la télémédecine à leur pratique afin d’atteindre et de traiter des patients qui ne pourraient pas autrement les consulter.
La télémédecine se prête toutefois mieux à certaines spécialités que d’autres. Selon l’American Medical Association, les radiologues, les psychiatres et les cardiologues sont les professionnels qui utilisent le plus souvent la télémédecine pour interagir avec leurs patients. Les allergologues, les gastro-entérologues et les gynécologues-obstétriciens sont ceux qui l’utilisent le moins.
3. Les dispositifs portables
Les capacités de surveillance avancées des dispositifs portables permettent aux médecins de proposer à de nombreux patients des soins à distance, notamment ceux atteints de maladies chroniques. Ces appareils, qui se présentent généralement sous la forme de bracelets intelligents, permettent de suivre un ensemble de données, comme la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang ou la température corporelle.
Une étude publiée dans Diagnostics a montré qu’un dispositif portable recueillant en permanence des données d’ECG, d’impédance cutanée, de température et d’activité physique pouvait prédire dans un délai de 10 jours les crises d’insuffisance cardiaque d’un patient, favorisant ainsi une intervention précoce. Plus généralement, une étude du Journal of Global Health a révélé que les médecins qui privilégient la détection précoce des maladies par le biais de technologies de surveillance portables améliorent l’efficacité des traitements et réduisent les coûts de santé.

4. La médecine régénérative
La médecine régénérative est un domaine multidisciplinaire en plein essor. Le but d’un traitement régénératif est de réparer, remplacer ou régénérer des cellules, tissus ou organes endommagés afin de leur restituer leur fonctionnalité normale.
Plusieurs domaines de médecine régénérative font actuellement l’objet de recherches particulièrement poussées, comme la thérapie génique, la thérapie cellulaire ou l’ingénierie tissulaire. Les autres domaines à fort potentiel comprennent la prolothérapie et les traitements à base de plasma riche en plaquettes (PRP).
Pour de nombreux chercheurs, la thérapie à base de cellules souches constitue l’un des domaines les plus innovants du secteur de la médecine. L’évolution des diverses avancées technologiques multidisciplinaires rend désormais possible les interventions liées aux cellules souches, comme l’amélioration des méthodes de reprogrammation des cellules iPSC et le développement de systèmes de bioréacteurs automatiques.
Qu’il s’agisse d’améliorer la survie neuronale et la fonction dans la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et la démence fronto-temporale, ou de renforcer le contrôle glycémique et de réduire la dépendance à l’insuline dans le diabète de type 1 et de type 2, le potentiel des thérapies à base de cellules souches est très vaste.
5. L’impression 3D
Comme dans le cas d’autres formes de technologies médicales novatrices, les médecins utilisent l’impression 3D à diverses fins. Cette technologie permet, par exemple, de créer des échafaudages osseux spécifiques à un patient, de fabriquer des implants de tissus articulaires, de produire des comprimés de divers médicaments ou encore des modèles anatomiques.
Un groupe de chercheurs a constaté que les comprimés à croquer imprimés en 3D destinés aux enfants atteints de certains troubles métaboliques (maladie des urines sirop d’érable, déficit en ornithine transcarbamylase (OTC) et déficit mitochondrial en énoyl-CoA hydratase à chaîne courte) permettaient de maintenir des taux d’acides aminés cibles tout aussi efficacement que les médicaments conventionnels. Ce médicament a également réduit les fluctuations du taux sanguin, permis d’administrer des associations médicamenteuses dans un seul comprimé, et amélioré l’acceptation du patient et l’observance du traitement.
Un autre groupe de chercheurs a réussi à imprimer en 3D des tissus pulmonaires alvéolaires dotés de structures fonctionnelles et multicouches qui ont répondu physiologiquement à une infection. Ce domaine s’accompagne d’un corpus de littérature en cours de développement qui offre beaucoup d’espoir.
Au sein de la communauté Sermo, un médecin a déclaré que : « L’impression 3D a révolutionné la création d’organes et de tissus artificiels, ouvrant de nouvelles possibilités en matière de médecine régénérative et de personnalisation des prothèses. Des organes et des tissus fonctionnels sont actuellement en cours de développement à des fins de greffe et dans le cadre d’essais médicamenteux afin de réduire les délais d’attente de greffe et d’améliorer les résultats obtenus par les patients. »
6. L’édition génique CRISPR-Cas9
CRISPR-Cas9 est une technologie d’édition génique qui utilise l’enzyme Cas9 et un ARN guide pour cibler et découper des séquences d’ADN spécifiques. Suite à cette découpe, les chercheurs peuvent retirer, insérer ou modifier le matériel génétique des cellules vivantes.
Un article publié dans Global Medical Genetics indique que la technologie CRISPR pourrait traiter un éventail de maladies héréditaires. Dans une application clinique de CRISPR, des chercheurs ont réussi à éditer des gènes in vivo chez des patients atteints d’amaurose congénitale de Leber par vecteur viral AAV. La modification ciblée de la mutation causale des cellules rétiniennes a entraîné des améliorations mesurables de la vision.
D’autres chercheurs ont démontré une correction ex vivo de mutations pathogènes dans les CSH de patients atteints de bêta-thalassémie grâce à CRISPR, entraînant une synthèse de l’hémoglobine restaurée. Cette étude de validation suggère qu’il pourrait potentiellement s’agir d’un traitement curatif pour la bêta-thalassémie.
Les chercheurs reconnaissent le potentiel de CRISPR tout en exhortant la prudence. En effet, si cette technologie se développe très rapidement, elle s’accompagne toutefois de défis, et notamment dans le domaine de l’éthique. En 2019, un groupe de scientifiques a recommandé un moratoire sur l’utilisation clinique de l’édition de la ligne germinale tant que ses implications éthiques ne seront pas complètement comprises.

7. L’intelligence artificielle
Afin de bien comprendre la croissance fulgurante de l’IA dans les soins de santé, il suffit de se rappeler que sa valeur marchande correspondait à environ 400 millions de dollars en 2014. En 2024, ce chiffre avait grimpé à environ 27 milliards de dollars. Et selon les prévisions d’analystes, il pourrait atteindre 614 milliards d’ici 2034 Si ces estimations s’avèrent correctes, cela représenterait un taux de croissance annuel moyen d’environ 44 % sur 20 ans.
Selon certains médecins de la communauté Sermo l’IA « changera la pratique médicale que nous connaissons aujourd’hui » en améliorant les diagnostics et les schémas thérapeutiques, et en réduisant les coûts.
Si l’on peut s’attendre à d’autres développements dans le domaine de l’IA dans un futur proche, cette technologie présente d’ores et déjà des applications importantes sur le plan économique, opérationnel et clinique. Des chercheurs des National Institutes of Health (NIH) ont par exemple développé un algorithme d’IA appelé « TrialGPT », qui simplifie le processus de correspondance de volontaires potentiels et d’essais de recherche clinique pertinents. Par ailleurs, un livre blanc du Forum économique mondial indique qu’un laboratoire pharmaceutique de premier plan type pourrait économiser plus de 1 milliard de dollars en seulement cinq ans en utilisant l’IA générative pour optimiser la conception de ses essais et déployer des essais cliniques décentralisés.
À un niveau plus micro :
- L’IA peut potentiellement améliorer considérablement la détection précoce du cancer du poumon, avec un vaste éventail d’applications possibles, comme la reconstruction d’images, la segmentation et les programmes de dépistage personnalisé.
- En dermatologie, l’IA améliore déjà la sensibilité et la précision du dépistage des lésions cutanées, y compris les cas malins.
- Dans le domaine de la cardiologie, le paysage diagnostique est également en cours d’évolution à mesure que les algorithmes générés par l’IA améliorent la précision et l’efficacité de l’interprétation de diverses modalités de diagnostic, qu’il s’agisse d’électrocardiogrammes ou d’imagerie avancée.
On constate aussi que l’IA joue un rôle clé dans la croissance soutenue du secteur de la télémédecine, en particulier dans la fourniture de soins à distance accessibles, efficaces et personnalisés. Enfin, l’IA optimise les capacités de la robotique, de l’impression 3D et d’autres technologies évolutives.
8. La robotique
Comme l’IA, la robotique n’a rien de nouveau. En revanche, son potentiel d’utilisation se développe très rapidement. Aujourd’hui, les systèmes assistés par robotique peuvent effectuer des interventions mini-invasives avec une plus grande précision chirurgicale, offrant au patient des incisions plus petites et des temps de récupération plus rapides. Des chercheurs ont notamment démontré que le système robotique da Vinci Single Port (SP) permettait d’effectuer des gastrectomies distales à port unique en toute sécurité au moyen d’une incision de Pfannenstiel. Cette intervention s’est traduite par une cicatrisation minimale, des durées d’hospitalisation plus courtes (trois jours en moyenne ) et aucune complication postopératoire majeure chez certains patients atteints d’un cancer de l’estomac.
Outre son impact actuel et potentiel dans le domaine de la chirurgie, la promesse de la robotique s’étend également à la rééducation, au suivi des patients (y compris à la télésurveillance) et aux prothèses.
Que pensent les autres médecins des progrès accomplis en matière de technologie médicale et de soins de santé ?
Il n’est pas toujours évident de connaître toutes les dernières actualités médicales avec un emploi du temps chargé. Fort heureusement, la communauté médicale en ligne de Sermo vous présente toutes les mises à jour qu’il vous faut à portée de main.
En devenant membre de Sermo, vous rejoindrez un réseau mondial de 1 million de médecins qui collaborent pour améliorer leurs connaissances dans le domaine des avancées technologiques ou dans le cadre d’autres questions qui façonnent la profession médicale. Outre la possibilité de discuter des futures technologies médicales avec vos confrères, Sermo vous permet de faire avancer la recherche médicale en répondant à des enquêtes indemnisées.